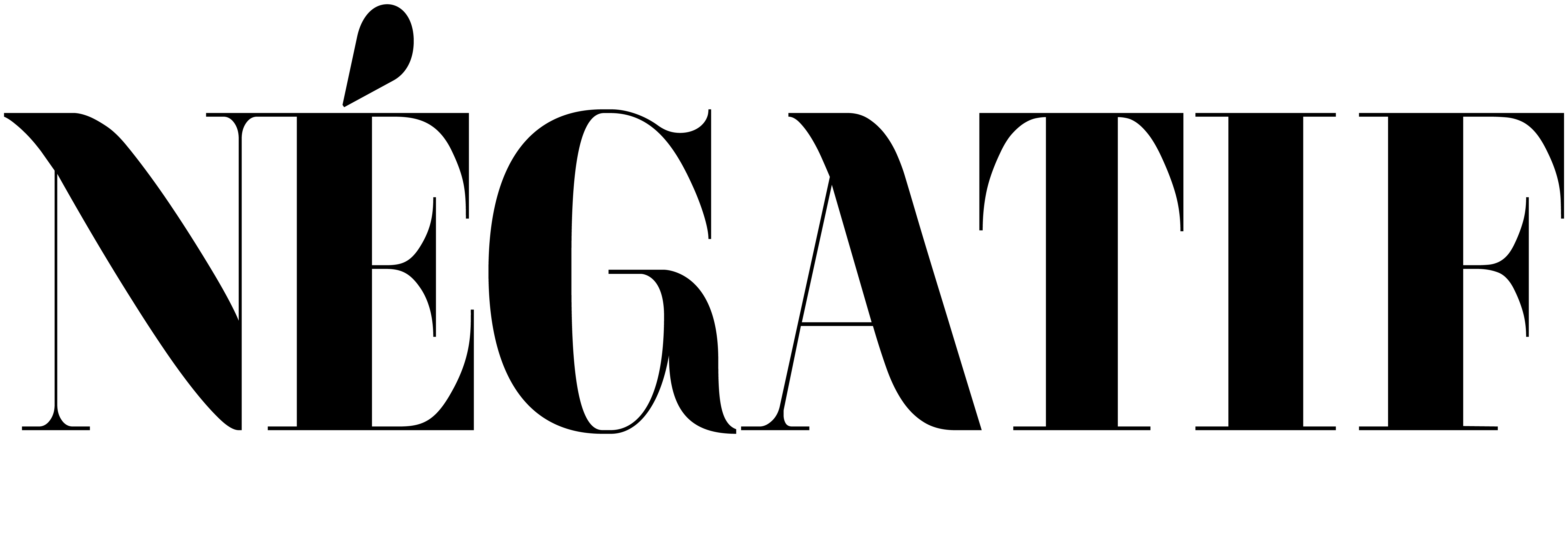Lieu:
Festival d’Avignon
Durée:
35 minutes
Animateur:
Thibault Elie
Date:
31 juillet 2019
Célèbre pour être l’acteur fétiche des films de Leos Carax (Les Amants du Pont-Neuf, Mauvais Sang, Holy Motors), ayant joué pour de grands cinéastes contemporains (Claire Denis, Harmory Korine, Claude Lelouch, Pierre Schoeller), Denis Lavant est aussi un fidèle des plateaux de théâtre. Dans le OFF du Festival d’Avignon il interprète Krapp, le seul personnage de la pièce La dernière bande écrite par Samuel Beckett. Mise en scène par Jacques Osinski —avec qui Denis Lavant a déjà travaillé plusieurs fois — au théâtre des Halles , c’est l’histoire d’un vieux monsieur qui réécoute sa voix parlant de son passé, enregistrée et rangée dans une boîte qu’il sort à chaque anniversaire.
Un matin ensoleillé, je rejoins Denis Lavant pour discuter de son interprétation du personnage de Krapp. Scie musicale et flèches dans le dos, il a écumé la brocante de la place des Carmes d’Avignon où il a récupéré un petit tampon d’imprimerie datant de 1932. Apprenant que l’entretien sera traduit en anglais, il commence à me raconter l’histoire d’un film turc qu’il a joué à Londres, dans lequel il jouait un malfrat français…un film qui n’est jamais sorti. Ce rapport entre passé et présent, entre celui qu’il était il y a 30 ans et celui qu’il est aujourd’hui entrent en écho avec La dernière bande dont nous avons parlée l’heure qui a suivi.
Quel rapport entretenez-vous avec l’oeuvre de Samuel Beckett ?
Beckett est un grand artiste, un grand écrivain qui est allé très loin dans une quête personnelle, dans le noir. Je le connais depuis longtemps : j’ai toujours adoré son humour. Il a à voir avec le burlesque en fait, sinon le clown, ce truc là de personnages qui sont un peu décalés, en tout cas marginaux, asociaux, dans une sorte de solitude. Il trimballe donc un peu ce burlesque. D’ailleurs Beckett a fait un film avec Buster Keaton qui s’appelle Film. C’était sur la fin de la vie de Buster Keaton et qui est pas du tout un film drôle (rires). Mais il utilise un peu la silhouette de Keaton, un peu les slapsticks. Mais dans son rythme très très lent et ça donne un peu le ton. En même temps c’est un grand littéraire, il connaît ses classiques comme on dit.
Il y a une figure très inspirante chez Beckett : dans la Divine Comédie de Dante il y a au Purgatoire un être, Belacqua, qui est au purgatoire simplement parce qu’il n’a aucune volonté de faire quoi que ce soit. De faire ni le bien ni le mal, il est dans une sorte de prostration, de se dire à quoi bon, une sorte de àquoiboniste avant Dutronc… C’est un peu la matrice des personnages de Beckett qui sont dans une grande inertie et qui en même temps carburent à fond, qui ne sont pas inertes et ont une pensée très active mais sont dans une forme de prostration, d’immobilisme parce que trop de pensée.
Est-ce que toutes les pièces de Beckett travaillent sur le même registre au théâtre ?
Il y a deux ans avec Jacques Osinski on a joué un des derniers textes de Beckett, Cap au pire. C’est une sorte de long tissu d’une sorte de navigation. Comme il n’y avait de didascalies — ce n’était pas fait pour le théâtre — et que les ayants-droits de Beckett sont assez scrupuleux par rapport à son oeuvre, on avait fait cela de façon minimaliste. J’étais debout sur une sorte de carré blanc qui s’illuminait, face au public et pendant une heure et demie sans bouger à défiler le texte. (commence à déclamer la réplique) On était dans un vrai immobilisme avec la parole qui était présente tout le temps donc avec aussi la pensée.
La dernière bande est un autre mode : il y a très peu de paroles directes, quatre pages en tout. Tout le reste c’est presque un acte muet…Et ça ne me dérange pas. Tout ce que l’on joue est exactement ce qui est inscrit par Beckett. Sauf que l’on a pris le parti avec Jacques Osinski de jouer chaque chose concrètement et non pas essayer d’aller vers une fluidité ou un naturalisme. (lit le texte) “Krapp demeure un moment immobile”. Donc on le joue à fond. Ce sont des moment que l’on a choisi de jouer complètement. Ça installe un rapport au présent pour le spectateur. On peut le jouer de façon beaucoup plus ramassée.
Quand je commence à me taire et à être dans l’immobilité, le rapport au temps commence à être totalement subjectif. Mais, finalement, comme on l’a défini en répétition en mettant des paramètres — tu peux faire durer encore plus, c’est un peu long là — à mon avis il y a organiquement une mesure. La pièce dure sensiblement à peu près le même temps chaque fois. Mais c’est vrai que c’est particulier au début et puis ces moments-là de prostration…

À quoi pensez-vous à ces moments-là, face au public ?
À tout. Et en même temps c’est libre. Je vois le public. J’essaye de m’évader, c’est-à-dire de trouver un interstice entre les spectateurs. De pas être dans le regard des spectateurs et en même temps d’être conscient de ma respiration, de mon corps, de mon immobilité, de chercher un calme et en même temps d’être dans une pensée, de vagabonder en fait et en même temps d’être dans un rapport en disant “Bon, jusque là ça va, je pousse encore, bon, il va être temps de…” et puis de laisser venir, la cessation de ce moment-là, le soupir. C’est ouvert, c’est d’être là puis de s’absenter mais de chercher cette qualité de moment qu’on peut éprouver quand on est seul, rentrer dans une pensée et s’en foutre de ce qu’il y a autour. Sauf que là effectivement je suis conscient qu’il y a 150 regards qui sont braqués sur moi (rires).
Qu’avez-vous compris du personnage de Krapp ? L’avez-vous interprété à votre manière ?
Il y a une partition ! En général dans ce cas-là je me déplace vers le personnage. Ce que donne Beckett dans la bande enregistrée et dans la bande qu’il enregistre ce sont des éléments de la vie de ce personnage, de son état de solitude. On trouve un personnage qui fête son anniversaire avec un rituel. Depuis des années il écoute une vieille bande qu’il a enregistrée et il en enregistre une. Là il a 69 ans et il écoute une bande enregistrée trente ans auparavant où il parle d’une bande qu’il a lui-même enregistrée douze ans auparavant donc quarante-deux ans avant ses 69 ans. Ca fait part de trois moments de sa vie et ça raconte quelque chose d’une grande période de vie d’un personnage qui avance…et en même temps ce qui est intéressant avec la bande enregistrée c’est que c’est un écho d’un présent d’une autre époque. Il est toujours dans une attitude plus critique en étant plus âgé par rapport à ce qu’il a enregistré les années d’avant. Donc c’est particulier.
Le travail le plus important a été d’enregistrer la bande, de rendre crédible l’enregistrement d’un type de 39 ans, de trouver une énergie, un rythme, une sorte d’aplomb, de prétention même qui est autre que celle qu’il a à 69 ans. Ensuite pour moi c’est de rentrer dans un rythme décrit par Beckett : je me mets avant tout au service de la partition. Beckett dit que Krapp voit mal, qu’il entend mal et qu’il a une démarche laborieuse. Donc je me suis appliqué à faire cela. Un truc absolument concret — ça peut paraître idiot mais c’est comme ça que je travaille — j’ai trouvé des chaussures dans une brocante à Paris, des vieilles chaussures de l’armée américaine, et je me suis dit “Ah voilà, c’est exactement ça qu’il me faut !”. C’est à la fois de belles chaussures et des chaussures qui sont bien, qui sont raides, où l’on est un peu engoncés et qui m’aident à avoir cette démarche qui est un peu chaplinesque aussi…mais un peu de vieux, un peu laborieuse comme c’est décrit.
C’est donc utiliser les éléments du texte et voir comment ça retentit chez moi émotionnellement aussi. Ce qui me touche dans ce texte c’est que Beckett l’a écrit en pensant à une femme qu’il a aimée, beaucoup aimée et qui est morte d’un cancer. Il y a cette chose de se souvenir des yeux, du regard. En fait c’est “Adieu à l’amour”. C’est ce qui est dit à un moment et c’est ça que Krapp va rechercher dans la bande : il veut écouter ce moment où il était encore dans une relation amoureuse et qu’il a décidée d’arrêter pour se consacrer à son oeuvre. Ce qui est étonnant c’est qu’il y a aussi quelque chose de l’autobiographie et d’authentique de la part de Beckett mais il le stylise, il le transmet dans un personnage, dans Krapp. Qui veut dire “nul” en anglais non ?
Oui c’est écrit “Krapp” dans le texte mais “Crap” en anglais ça veut dire “Merde”…
Merde…Monsieur Merde (rires) [personnage interprété par Denis Lavant dans les films de Leos Carax Merde (2008) et Holy Motors (2012)]
Comment vous préparez-vous pour jouer la pièce tous les jours ?
Rien. Je fais rien. Si vous voulez à chaque spectacle il y a une manière différente de l’aborder. Quand je fais de grands monologues comme Cap au pire — j’avais une heure et demie de texte — ma manière de me rassurer c’était deux ou trois heures avant le spectacle de marcher dans la ville et de me dire tout le texte pour le préparer, comme pour chauffer mon instrument. Dans un cas comme La dernière bande où j’ai très peu de texte il s’agit d’être dans l’acte de condenser du présent. Je m’efforce de rien faire (rires). Surtout de pas préméditer, de pas répéter la pièce mais d’arriver disponible pour plonger dans cet état là. C’est particulier parce que j’ai pas grand chose à quoi me raccrocher sinon de me calmer. J’arrive une heure avant au théâtre, je m’habille, souvent je mets mes affaires en place…

La seule préparation importante que je fais — et d’ailleurs faut que j’y pense — c’est d’acheter des bananes. Tous les jours je fais un casting de bananes dans les différentes épiceries et j’essaye de trouver des bananes qui me plaisent, qui soient grosses mais pas trop grosses quand même, qui soient bien, bien quoi, qui se tiennent (rires). Ca parait rien mais des fois je mets du temps, c’est pas évident tous les jours. Des fois il y a pas les bananes qui conviennent (rires).
De quoi avez-vous discuté avec Jacques Osinski pour aborder cette partition de Beckett ?
A partir du moment où on était d’accord pour faire ce texte ensemble — et moi je trouvais ça génial de faire une autre approche de Beckett après Cap au pire — la première chose qu’il m’a proposée c’est de prendre vraiment en compte tout cet acte muet, tout le début de la pièce particulièrement, qui peut être très réduit mais ici de dilater le temps, d’entrer dans un rapport au temps qui est pas dans un temps quotidien, qui est pas un temps raisonnable. C’est vraiment cela l’enjeu principal. Après effectivement on a lu le texte ensemble, on s’est questionnés sur des mots. Jacques Osinski a pris le texte anglais en regard aussi pour essayer de scruter la partition, de la comprendre le mieux possible…et puis aussi d’essayer d’aller à une forme de pureté, de pas avoir d’idée toute faite sur le ton. J’avais vu le personnage de Krapp joué dans d’autres mises en scène et on pourrait penser au premier abord qu’il y a un ton cynique et ironique dans sa manière, dans son ricanement. On a essayé d’éviter ça.
Par exemple un moment à la fin de la pièce a été précieux. Krapp dit : Sois de nouveau, sois de nouveau. Toute cette vieille misère. Une fois ne t’a pas suffi. Rien que ce groupe de mots — une fois ne t’a pas suffi — je l’ai dans l’oreille avec une forme d’ironie un peu cynique. Si on va au sens plein du terme c’est dans cette affirmation quelque chose comme “Ah oui, tu as besoin de revivre les choses une autre fois. Tu es obligé d’enregistrer pour dédoubler le temps.” Plus on va au coeur du sens des phrases et des mots, plus ça retentit largement à mon avis. Jacques Osinski a pour ça un regard très précieux et une écoute très fine.
Quels ont été les retours du metteur en scène pour ajuster votre jeu ?
Souvent à l’issue des représentations il peut témoigner de paramètres. Par exemple là ça a été un peu vite, ou l’enregistrement est pas assez intime. C’est délicat. Dans cet exercice solitaire le danger c’est d’avoir peur d’ennuyer les gens, donc de raccourcir les pauses, ou alors de théâtraliser, c’est-à-dire de jouer plus pour le public. Il faut être dans l’écoute, au premier degré de l’écoute. Le danger peut aussi être de surjouer l’écouter ou d’illustrer l’écoute. L’enjeu qui se définit chaque soir est d’aller dans la nouveauté de cet état d’écoute et de l’enregistrement…et aussi de condenser vraiment les temps de songerie. Hier par exemple Jacques m’a dit : Tu as été un peu vite dans les déplacements (rires) Tu as été un peu trop vif. C’est vraiment sur des paramètres assez précis, assez fins…mais qui pour moi sont assez subjectifs.
Il y a des représentations où les gens rient beaucoup au début et moins à la fin. Il ya des fois où les gens perçoivent l’humour de Beckett, de la situation Il y a des représentations qui sont complètement silencieuses, pour moi c’est un peu une épreuve Au coeur de cette situation je ne sais pas du tout comment c’est appréhendé par le spectateur. Parfois j’ai pu penser que les gens s’emmerdaient, qu’ils n’étaient pas là, qu’ils étaient hostiles. Puis à la fin ils étaient ravis ! Plusieurs fois Jacques m’a dit : “C’est exactement ça !”. Des fois je sens en exécutant qu’il y a une émotion patente qui parvient au spectateur. De toute façon c’est aléatoire, c’est du théâtre (rires).
Est-ce que vous vous ajustez en fonction de ces réactions différentes des spectateurs ?
Je ne m’ajuste pas. J’essaye de pas être influencé par ça. C’est-à-dire de continuer vaille-que-vaille ma route. Il y a des des repères, des moments où sur telle réplique les spectateurs réagissent, rient. Si une fois ils ne rient pas, je ne vais pas me laisser déstabiliser. Je ne vais pas essayer non plus de les encourager dans la rigolade. Une fois, la pire réaction de spectateurs, m’a forcé à réagir (rires). Trois dames d’un certain âge, qui venaient manifestement se divertir, sur mon dos (rires), qui parlaient entre elles dès le début, qui étaient dispersées. Et au moment où je glisse sur la banane et où je la repousse vers le public. Tout ce qu’elles trouvent à faire c’est de dire “Oh” et de me rejeter la banane sur scène.
Et là, dans ma tête de Krapp, je me suis dit : “Qu’est-ce que je fais ?”. Normalement, il est écrit dans le texte que je pousse la banane dans la fosse d’orchestre. Là, je n’ai pas de fosse d’orchestre. J’ai réfléchi assez vite, j’ai fait le contat, si je rejette la peau elles vont me la rejeter encore et on va en finir du spectacle, on va faire une improvisation, ça va être drôle mais on va perdre de vue le sujet. (rires) Donc j’ai poussé la peau de banane sous le bureau. Et ça a pas loupé la deuxième fois où je jette la peau de banane, elles ont dit “Oh” et l’ont rejetée à nouveau. Là je les ai ignorées totalement. Après ça dénature le spectacle. Pour chaque spectacle c’est pas d’entrer en complaisance avec l’humeur des spectateurs mais de les amener, de canaliser le truc vers ce que l’on veut raconter en utilisant cette énergie, cette attention et cette humeur qu’il y a en face. En étant le plus possible imperturbable dans cette solitude là.

Quel est votre secret pour contrôler votre corps au maximum pendant la pièce ?
J’ai pas de secret. Avec ma pratique et ma formation j’ai quand même une maîtrise physique assez bonne. J’ai beaucoup travaillé sur le mime, l’acrobatie, la danse. J’ai une conscience de mon corps très présente. Et ça ne me gêne pas du tout d’être immobile. Après c’est un exercice mental : c’est d’accepter l’immobilité, ce n’est pas de se contraindre. C’est brusquement de partir de là-dedans quoi. Tout part la respiration. C’est pas du yoga — j’aime pas ça — ni de la respiration forcée mais je suis conscient de trouver du calme en moi. Et puis c’est tout le temps relié par l’imaginaire. A partir du moment où ça continue à bouger dans ma tête, à être dans une dynamique. Être dans l’immobilité c’est quand même être dans une dynamique de pensée, ou même physique. C’est pas d’être un WC, c’est d’être là et tout est tenu par le regard, par ce qui est encore en mouvement — c’est-à-dire la pensée. C’est réduire le mouvement général physique à un mouvement interne, y compris avec la respiration. Voilà, c’est pas un secret, c’est juste d’en avoir conscience. C’est comme ça que je pratique (rires).
Venez-vous chaque année au Festival d’Avignon ?
Non ce n’est pas systématique. J’y vais depuis longtemps, depuis le début des années 1980, où j’ai fait de la Commedia dell’arte. J’ai été dans le “In”, j’ai été dans le “Off”. J’ai bien arpenté la ville et les théâtres. J’ai vu un peu évoluer le festival aussi. J’y vais quand la production dans laquelle je suis le demande. J’appréhende un peu mais je suis toujours content d’y être parce que j’apprécie cette ville. Je trouve que le Festival est devenu une sorte de chose, de boursouflure terrible, mais bon… Des fois ça peut m’agacer, des fois ça me met en colère…
Par boursouflure vous vous parlez de l’inflation des spectacles ? (1592 cette année dans le “Off”, NDLR)
C’est-à-dire qu’il y a déjà un hiatus indécent, l’abîme qu’il y a entre le “In” et le “Off”. Entre le privilège, le confort, l’argent qui est mis dans le “In”. Des lieux qui ne sont utilisés qu’une fois par jour pour un spectacle. Et la manière où dans le “Off” les salles reçoivent une dizaine ou une quinzaine de spectacles par jour, tout le monde est entrain d’afficher, de tracter dans les rues pour promouvoir son spectacle. Il y a une sorte de succession entre eux, on a pas de le temps de s’installer. Ce n’est pas le même régime, il y a deux régimes différents. C’est un peu un reflet de la société dans laquelle on est aussi.
Cette distinction voire ce fossé entre le “In” et le “Off” n’était-il pas déjà présent il y a 30 ans ?
Ça a toujours été comme ça mais je trouve que l’abîme s’est accru entre le “In” et le “Off”. J’aurais rêvé à un moment donné de remettre tout en question, au moment où il y a eu les grèves pour les droits des intermittents du spectacle en 2003. Mais en fait le propos a été détourné, le Festival a été clos et on a complètement noyé le poisson. Alors que c’est là qu’il y a avait un problème à régler, de trouver un statut équitable par rapport à l’ensemble du festival.
Alors forcément le “In” il y a des “produits”, le festival est entré dans quelque chose de plus en plus commercial avec des produits mis en valeur. La plupart des spectacles du “In” sont joués, sont achetés, sont vendus. Ce sont des spectacles qui vont tourner. Dans le “Off” c’est la foire où il y a des spectacles comme le mien qui sont déjà amenés à être joués ailleurs et des gens qui viennent trouver des acheteurs, qui viennent proposer leur travail, leur création et qui en sont souvent pour leur argent. Tout le monde n’a pas les mêmes chances ! Moi j’ai de la chance parce que j’ai fait du cinéma donc j’ai une image médiatique. Forcément les gens vont venir me voir jouer au théâtre aussi pour ça. Je n’ai pas besoin de tracter forcément. Et puis il y a des gens qui sont totalement inconnus qui ont besoin de faire la retape.
Mais le “Off” c’est en même temps monstrueux et drôle : on trouve toute la palette possible du spectacle vivant. Il y a aussi bien du stand-up que des pièces très intellectuelles, des pièces baroques, que des trucs très amateurs. En même temps ça me révolte un peu et en même temps je trouve ça marrant. Je trouve qu’il y a quand même quelque chose qui est très aimable, en tout cas qui circule qui est assez solidaire et fraternel qui circule parmi les gens du “Off”. Et ça c’est ça qui est chouette (rires).
Avez-vous le temps d’aller voir des spectacles du Festival ?
J’ai pas été voir grand chose parce que je joue… J’ai été voir un ami, des amis surtout. Il y a tellement de gens qui ont envie que j’aille voir leurs spectacles. Je suis allé voir un ami qui s’appelle Hovnatan Avédikian qui joue au théâtre Girasol un spectacle qui s’appelle Europa d’après un auteur qu’il m’a fait découvrir et qui s’appelle Aziz Chouaki. Il fait une sorte de solo avec un musicien qui fait plein de personnages. J’ai été avoir des amis qui sont sur, une troupe foraine belge avec qui j’ai travaillé quand j’étais môme, donc c’est la famille aussi. J’ai été voir un truc très bien : un couple qui fait un truc de portée de trapèze autour d’Erik Satie dans une pièce qui s’appelle Heures Séculaires.
Un truc qui m’a épaté c’est un compagnie qui fait du trapèze volant, ça s’appelle (prend un accent anglais) Hurt me tender, ils sont très très performants, tout ça mis en scène dans une humeur rock. C’est pas qu’une performance circassienne, ils jouent quelque chose et ils tiennent une sorte de densité de jeu un peu inquiétant, de voyous un peu genre West Side Story mais sans la musique, sans le côté chorégraphié, quelque chose de bas-fonds. Il y a un jeu d’agression, de tendresse, d’étreinte, de baston. C’est très beau et ils le tiennent admirablement. A côté de ça ils font des figures de trapèze volant qui sont très périlleuses ! J’ai trouvé ça admirable.
Si vous n’allez pas voir des spectacles la journée, que faites-vous ?
Je me promène, je rencontre des gens, je mange des huîtres, je vais pas mal au bouquiniste, je me pause. Ah si quand même j’avais une lecture à préparer en plus au théâtre des Carmes que j’ai fait le 18 juillet. Ça m’inquiétait un peu, ça me mettait vraiment la pression. C’est un texte qui s’appelle L’Acte d’amour d’un jeune auteur, Yann Karaquillo, qui m’a proposé et où je fais pleins de personnages. Un très beau texte et que je tenais vraiment à faire entendre. C’est une sorte de performance parce que c’était très peu répété et c’était pour moi assez risqué comme prestation. Mais je l’ai fait et ça s’est très bien passé. Maintenant j’ai des journées un peu plus vacantes !
Mais ça passe vite. Toute la journée est sous-tendue par le fait qu’il y a La dernière bande à faire à 21h30. Donc il ne faut pas s’énerver (rires). Souvent je bouquine, je tourne, je fais plusieurs tours de ville, je cherche des bananes, je me nourris, je rencontre des gens, voilà. Il y a pleins de choses à faire quoi (rires).

Selon vous quelle serait la bonne raison d’aller voir La Dernière Bande ?
Pour moi c’est de trouver un écho à son propre passé. C’est à ça que ça ramène. Moi c’est à ça que ça me ramène. A n’importe quel âge que l’on est c’est brusquement d’avoir cette conscience de toute cette manière dont la présence humaine, à un moment donné à un n’importe quel moment de la vie, c’est comme un iceberg où il y a le présent qui est là, qui est très court très éphémère, et il y a déjà du passé, des souvenirs, de la mémoire qui est derrière soi, qui s’accumule, qu’on a, qu’on transporte avec soi et c’est cette conscience là qui est énorme je trouve.
Quel texte de Beckett conseillez-vous pour découvrir cet auteur ?
Il y a un roman de Beckett que j’adore où il y a tout ce ton-là, il y a un personnage, il y a de l’humour, il y a une conscience tragique de l’existence, c’est Molloy. Voilà. Sinon il y a Fin de partie qui est une pièce, on a peut-être le projet de le faire avec Jacques Osinski ensuite, la pièce de Beckett que je préfère. L’année prochaine peut-être, ou dans deux ans !
texte Samuel Beckett
mise en scène Jacques Osinski
avec Denis Lavant
scénographie Christophe Ouvrard
lumières Catherine Verheyde
son Anthony Capelli
costumes Hélène Kritikos
photographies Pierre Grosbois